“Durant une grande partie du xxc siècle, le paysage politique de l’Europe occidentale a été caractérisé par une ligne de démarcation entre la gauche et la droite : elle séparait ceux qui voulaient davantage de planification, de contrôle de l’Etat et de redistri¬ bution des richesses de ceux qui en souhaitaient moins. Toutefois, autour de 1990, la gauche avait admis beaucoup de la philosophie libérale de la droite et la différence de leurs politiques économiques respectives n’était qu’une affaire de degré.
Mais à mesure que la division gauche-droite s’amenuisait, une nouvelle fissure commençait à apparaître dans le paysage politique. D’un côté se situaient les défenseurs de la souveraineté nationale, telle Margaret Thatcher, qui s’opposaient au pouvoir croissant des institutions européennes. En face se dressait Jacques Delors, qui faisait valoir que les nations européennes déclineraient inévitablement, à moins qu’elles n’acceptent de tra¬ vailler ensemble à l’édification de politiques communes. Cette ligne de fracture avait peu à voir avec la division traditionnelle entre la gauche et la droite.
Le débat sur la souveraineté n’est pas nouveau : il a pris nais¬ sance dans les années cinquante. A cette époque, Jean Monnet a été le premier inspirateur du mouvement pour une Europe fédérale et le général de Gaulle s’est battu pour une « Europe des patries » . Delors et Thatcher ont ranimé et développé les credos de Monnet et de Gaulle. Mais cette controverse n’a acquis un rôle dominant en Europe occidentale qu’à la fin des années quatrevingt quand — en partie en raison de l’autorité prise par Delors sur la Commission européenne — la Communauté européenne s’est mise à exercer une influence puissante et parfois gênante sur les politiques nationales.
Au début des années quatre-vingt, la Communauté était une organisation terne et somnolente dont il était rare que les réalisations soient dignes d’être signalées. Quand, en 1985, Delors devint président de la Commission, il y injecta un dynamisme nouveau. Il fut l’instigateur du plan destiné à établir un marché unique à la fin de 1992 et de l’Acte unique qui devait donner à la Communauté les moyens de réaliser cette ambition. Mieux que beaucoup de Britanniques, Delors a compris le paradoxe du marché unique : l’abaissement des barrières nationales, qui jusqu’alors s’opposaient à la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, exigeait un important transfert de souveraineté aux institutions européennes. Aussi assigna-t-il à la Communauté de nouvelles cibles : union économique et monétaire et union politique.
C’est en septembre 1990, lors d’un voyage en Tchécoslovaquie, que j’ai rencontré Jacques Delors pour la première fois : son influence était alors au zénith. A l’aéroport de Prague, Jiri Dienstbier, ministre des Affaires étrangères de Tchécoslovaquie — qui avait été chauffeur de machines jusqu’à la « révolution de velours » un an auparavant — accueillit Delors comme s’il était un chef d’Etat. Un orchestre joua le dernier mouvement de la Neuvième symphonie de Beethoven, hymne non officiel de la Communauté. Celle-ci était en train d’acquérir d’autres signes extérieurs de dignité étatique.
Tandis qu’une escorte de huit voitures emmenait Delors vers les splendeurs baroques de Prague, un drapeau à douze étoiles d’or sur fond bleu roi n’a cessé de flotter le long du chemin. En janvier 1985, c’était Delors qui avait choisi pour la Commission ce drapeau qui, jusqu’alors, était celui du Conseil de l’Europe. Plus tard, sans consulter aucun gouvernement, Delors et les administrations du Parlement européen et du Conseil des ministres ont décidé d’en faire le symbole de la Communauté.
En juin 1986, lors du sommet du Groupe des Sept à Tokyo, la bannière aux douze étoiles a été dévoilée, à la grande surprise des premiers ministres européens qui étaient présents. Mais deux ans plus tard, les gouvernements européens, voire ceux du monde entier, utilisaient ce drapeau pour représenter la Communauté.
Le cortège arriva au château de Prague, où le président Vaclav Havel et Alexandre Dubôek, qui était alors président de l’Assem¬ blée nationale, donnaient un banquet officiel en l’honneur de Delors. Celui-ci semblait enchanté du profond respect que Tchèques et Slovaques témoignaient à la Communauté européenne, à la Commission et à la fonction de Delors. « Il y a cinq ans, jamais un président de commission n’aurait reçu un tel accueil », me dit-il avec fierté. Delors excitait ma curiosité, non seulement parce qu’il avait transformé la Communauté et était le socialiste de sa génération qui avait le mieux réussi, mais aussi en raison du trajet considérable que représentait sa carrière personnelle.
Son grand-père était un simple paysan de la Corrèze, région très pauvre du centre de la France, et son père, Louis Delors, avait travaillé comme garçon de recettes à la Banque de France. Né et élevé dans un arrondissement prolétarien de l’est parisien, Jacques Delors n’avait effectué qu’une scolarité réduite et n’était détenteur d’aucun diplôme universitaire.
C’est le sentiment d’être chargé d’une mission, sentiment ins¬ piré par une foi religieuse profonde, qui a poussé Delors à se diriger vers des horizons nouveaux. Il y a été aidé par une vive intelligence, une capacité de travail presque surhumaine et un sens aigu de l’opportunité. Fait inhabituel chez un homme politique, Delors combine une aptitude prodigieuse à engendrer des idées et un instinct pragmatique pour les mettre en œuvre.
Il est bien loin d’être le terne bureaucrate que représentent certaines caricatures. Il a joué au basket dans une équipe de première division, il est l’auteur d’écrits qui font autorité sur la musique de Dizzie Gillespie et de Dexter Gordon et il a créé un cinéclub spécialisé dans les films américains. Il met de la passion dans tout ce qu’il fait ou dit, ce qui le rend stimulant mais peu commode pour ses collègues. Il déborde d’une énergie nerveuse et d’une force émotive brute qu’il a de la peine à maîtriser. Malgré toutes ses réussites, il se sent souvent peu sûr de lui.
Delors est pétri de contradictions qu’il ne parvient pas toujours à surmonter. Il est socialiste et syndicaliste, mais il a collaboré un temps avec un Premier ministre gaulliste et, dans son for intérieur, il se définit comme démocrate chrétien . Il est catholique pratiquant, prend des positions morales et assure qu’il n’est pas ambitieux ; mais c’est un tacticien politique astucieux épris de pouvoir qui a dirigé la Commission de Bruxelles d’une main de fer. C’est un français qui défend sa vision d’une Europe unifiée.
Il a sans doute poussé le fédéralisme trop loin et trop vite : beaucoup de gens n’ont pas compris la Communauté européennne — qui est devenue en novembre 1993 l’Union européenne — ni apporté leur soutien à ce qu’il essayait de réaliser. En accroissant la puissance de Bruxelles, Delors a suscité la vague antieuropéenne qui a balayé l’Europe septentrionale en 1992 et 1993. Mais depuis l’époque de Monnet et de Gaulle, l’intégration européenne avait toujours fait deux pas en avant, un en arrière. A partir du moment où Delors a conduit le bal, quelques-uns l’ont suivi, d’autres ont pris la direction inverse, mais personne n’est resté indifférent à l’air qu’il jouait”.
(Source: Charles GRANT, “DELORS Architecte de l’Europe”, Georg Editeur, Chêne-Bourg, 1995, Traduit de l’anglais par Paul Alexandre)
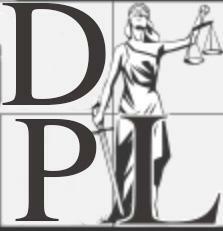
Commenti recenti